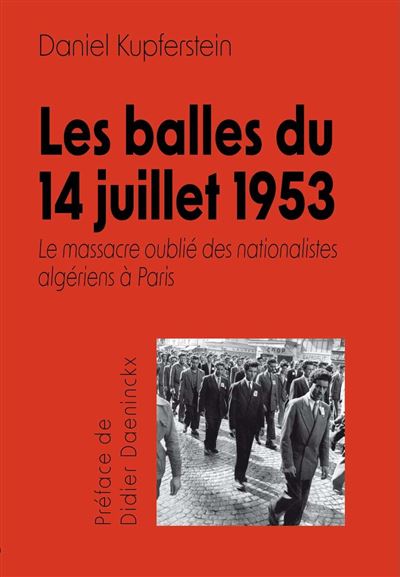
Le 14 juillet 1953, à l’occasion de la fête nationale, un défilé populaire, distinct du défilé militaire du matin, était traditionnellement organisé l’après-midi par le Mouvement de la paix, soutenu par le Parti communiste français (PCF) et des syndicats, dont la CGT.
Ce jour-là, les manifestants suivaient un parcours allant de la Bastille à la Nation. En queue de cortège se trouvaient les militants du Mouvement pour le Triomphe des Libertés Démocratiques (MTLD), venus revendiquer la fin du régime colonial en Algérie.
Alors que le cortège, fort de 10 000 à 15 000 personnes, dont environ 6 000 à 8 000 Algériens, arrivait à hauteur de la place de la Nation, la police ouvrit le feu sur la section algérienne du cortège, causant la mort de sept personnes (six Algériens et un militant de la CGT venu s’interposer) et faisant plus de 60 blessés, dont au moins 47 par balles.
Selon les témoignages, la police aurait tiré sans sommation sur une foule désarmée, provoquant la panique et un véritable carnage.
Les victimes n’ont jamais obtenu justice, ni en France, ni en Algérie. L’événement a été largement occulté de la mémoire collective des deux pays pendant des décennies.
Ce massacre s’inscrit dans un climat de répression du nationalisme algérien et de tensions coloniales, à moins de deux ans du déclenchement de la guerre d’Algérie.
L’événement a été rapidement effacé des mémoires officielles. Il faudra attendre plus d’un demi-siècle pour qu’il soit publiquement commémoré, notamment avec la pose d’une plaque à Paris en 2017.
Plusieurs témoignages et enquêtes, dont celle de Daniel Kupferstein, ont mis en lumière l’ampleur de la violence policière et les manipulations d’État visant à minimiser ou dissimuler les faits (notamment la disparition de la majorité des douilles et une instruction judiciaire lacunaire).
Le massacre du 14 juillet 1953, longtemps oublié, est aujourd’hui reconnu comme un épisode marquant de la répression coloniale en France et un « déclic » dans la montée du mouvement indépendantiste algérien. Il illustre la violence d’État face aux revendications anticoloniales et la difficulté de la société française à affronter certains pans de son histoire contemporaine.